[Interview] Christian Topalov : « Les philanthropes de 1900 avaient une vision de l’avenir »

Sociologue et historien, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales, Christian Topalov publie en cette fin d’année Philanthropes en 1900 : Londres, New York, Paris, Genève aux éditions Créaphis. Cette étude des acteurs et des formes de la philanthropie dans quatre grandes villes occidentales au début du XXe siècle rassemble les contributions de 13 chercheurs.
Avant la rencontre organisée à l’abbaye le 15 décembre, nous lui avons posé quelques questions par téléphone…
Qu’est-ce que la philanthropie des années 1900 avait de particulier, par rapport à celle qui s’exercera 50 ans plus tard ?
Christian Topalov : « Je peux surtout vous parler de la différence que je vois entre 1900 et aujourd’hui. Ces gens – qu’on peut appeler « philanthropes » ou encore « réformateurs », car il s’agissait au fond d’une même famille de personnes – voulaient, bien sûr, secourir leur prochain mais ils avaient tous, au-delà de leur activité immédiate de bienfaiteurs, une vision de l’avenir. Ces visions étaient diverses, mais elles comportaient des traits communs. D’abord, des diagnostics semblables sur l’origine des maux de la société. Pourquoi la pauvreté, la tuberculose, l’alcoolisme, toutes ces choses funestes qu’ils souhaitaient combattre ? La plupart pensaient que les individus n’étaient pas entièrement coupables de leur malheur. Bien sûr, certains croyaient que le paupérisme avait des causes morales mais, dans l’ensemble, ils cherchaient aussi des explications d’ordre social ou institutionnel. Ils disaient qu’il valait mieux prévenir que guérir. Cette idée de prévention signifiait qu’il fallait s’attaquer aux causes des maladies sociales : la démarche empruntait beaucoup au vocabulaire scientifique, au vocabulaire des sciences de la nature ou des sciences sociales naissantes. Il fallait en finir avec une charité irresponsable qui consistait à donner un sou au mendiant dans la rue. Sur le moment ce geste faisait plaisir à celui qui donnait comme à celui qui recevait, mais on ne savait jamais ce que le pauvre allait faire de son sou et, surtout, ce sou ne le sortait pas de la misère. Les philanthropes cherchaient de nouvelles méthodes, rationnelles, scientifiques. C’est à cette époque que furent élaborées des méthodes d’enquête sur les familles nécessiteuses qui allaient donner naissance, notamment dans les pays de langue anglaise, au case work (ou « travail au cas par cas »), méthode qui fut reprise par le service social à la française quelques décennies plus tard. Au delà des cas singuliers, il y avait aussi la mise en évidence de causes sociales du malheur. Si la tuberculose, par exemple, était une maladie du taudis, il fallait y répondre par la destruction des « murs qui tuent » et la construction de logements salubres, voire l’aménagement de nouveaux quartiers.

Christian Topalov (photo : Andrey N. Andreev)
Au fil de toutes ces actions et expérimentations, il se formait un personnel nouveau, dévoué mais surtout compétent, massivement féminin. Beaucoup moins en France, à vrai dire, qu’aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne, où l’économie charitable était plus puissante, plus florissante, capable d’adjoindre des salariées aux dames d’œuvres. C’est ce qui a permis l’émergence des professionnelles du service social. Les premières infirmières, aussi, sont nées de ce type d’initiative, avant que la Grande Guerre n’en fasse une véritable profession. On peut dire que c’était ça, les philanthropes de 1900. Ils étaient d’accord sur des diagnostics et des méthodes, mais se disputaient sur les institutions à promouvoir. Certains disaient « L’Etat doit rester en dehors de tout ça », les municipalistes disaient « il faut que les communes s’emparent de ces questions, parce que la philanthropie privée ne pourra jamais faire face à des besoins aussi vastes ». Malgré toutes ces divergences, cette activité philanthropique multiforme a donné naissance à l’Etat social du XXe siècle. La notion de droits sociaux – qui remplaçait la notion de libéralités – s’est imposée, mais tous les outils expérimentés par le monde philanthropique ont été mobilisés ensuite par l’Etat social. »
Et aujourd’hui ?
Christian Topalov : « Je n’ai pas fait d’enquête sur les philanthropes contemporains, mais ce qui me frappe c’est que le regain actuel de la philanthropie – on dit plutôt mécénat, bénévolat, ONG –, loin de préparer l’émergence de nouveaux droits sociaux, fleurit sur le recul de ceux-ci. C’est pourquoi cette philanthropie du début du XXIe siècle n’est pas identique à celle du début du siècle passé. Celle des années 1900 a fait naître quelque chose : l’Etat social, celle d’aujourd’hui, il me semble, naît de démantèlement progressif de celui-ci. Depuis Mrs Thatcher, le mot « réforme » a dramatiquement changé de sens et c’est une toute autre vision de l’avenir qui se met en place. »
A cette époque, la philanthropie s’exerçait-elle de façon différente à Londres, New York, Paris et Genève ?
Christian Topalov : « Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je retiendrai surtout deux points, qui me paraissent importants. Le premier tient à l’histoire politique des élites urbaines. New York, Paris et Genève, les trois cas sur lesquelles nous avons le plus travaillé, sont des villes très différentes à bien des égards. A la fin du XIXe siècle, elles connaissent cependant une expérience politique assez similaire : le petit peuple urbain s’est emparé du suffrage universel masculin. Dans ce contexte, ceux qui entrent en philanthropie et donnent naissance à cette floraison d’œuvres privées, ce sont des gens qui ont un profil semblable. Ils font partie d’anciennes élites urbaines, qui s’occupaient tout naturellement des affaires publiques de la cité et qui ont été chassées de leurs positions de pouvoir. Je n’ai pas le temps d’approfondir ici cette affirmation comme il le faudrait mais, si on prend le cas français, la période qui nous intéresse est marquée par l’élimination des institutions représentatives nationales et municipales de la classe dirigeante du Second Empire puis des élites monarchistes et catholiques qui contrôlaient encore le pouvoir politique sous la « République des ducs », au début de la Troisième République. Vers 1880, ces gens-là sont balayés par le suffrage universel. Beaucoup d’entre eux se reconvertissent, avec beaucoup d’enthousiasme et de conviction, dans les œuvres sociales. Les élites genevoises et les élites new-yorkaises, dans des contextes politiques très différents, ont parcouru le même type de trajectoire. C’est le premier point que je voulais mettre en évidence.

L’autre point important, c’est plutôt une différence entre Genève et New York d’un côté, et Paris de l’autre. A Genève et à New York, il y a une centralité très puissante des œuvres de la confession dominante. A Genève, il s’agit de l’Église nationale protestante, qui n’est pas la seule confession du protestantisme genevois mais qui est l’église instituée, officielle. A New York, c’est l’église épiscopalienne, confession de l’élite patricienne, à laquelle s’adjoint un mouvement évangélique, qui traverse les confessions protestantes dissidentes. Ces gens-là, à Genève et à New York, sont au cœur du monde charitable et marginalisent de façon très brutale les œuvres des confessions minoritaires, qui se bornent à desservir les immigrés récents : à Genève, une majorité de la population ouvrière venait de France ou d’Italie, à New York, c’étaient les Irlandais et Italiens catholiques et les juifs d’Europe de l’Est. Les œuvres tournées vers ces minorités confessionnelles sont totalement isolées du monde philanthropique dominant. A Paris, en 1900, les œuvres liées à la confession dominante – l’Eglise catholique – sont nombreuses et puissantes, mais elles constituent une région particulière du monde charitable. Celui-ci comprend aussi de vastes zones d’œuvres « neutres » du point de vue confessionnel, auxquelles sont connectées les œuvres israélites et parmi lesquelles sont entièrement immergées les œuvres protestantes. Conséquence intéressante, à Genève et New York, la centralité de la confession dominante entraîne une omniprésence du langage religieux dans la façon dont les activités philanthropiques s’expriment et définissent leurs objectifs. Sur ce point aussi, la différence est très forte avec le cas parisien. A Paris, de nombreuses œuvres philanthropiques forment un ensemble autonome par rapport à la matrice de la charité catholique et le langage réformateur l’emporte sur le langage religieux pour décrire les œuvres et leur action. La différence des rapports entre confession dominantes et confessions minoritaires est ainsi au principe d’une forte différence entre les mondes philanthropiques dans ces villes. »
La famille Goüin, qui gérait la Société de construction des Batignolles et qui a acquis l’abbaye de Royaumont en 1905, est-elle représentative de cette philanthropie du tournant du siècle ?
Christian Topalov : « Cette question tombe merveilleusement bien. Les Goüin sont très présents dans nos travaux et dans nos bases de données. La famille Goüin est typique de ce qu’on pourrait appeler « l’establishment réformateur français » de l’époque. Ils ont, cependant, une particularité : ce sont des industriels qui s’engagent en philanthropie à la première personne. Ce n’est pas si fréquent chez les patrons français de la période. Sans doute, côté protestant, un Jules Siegfried, négociant en coton, est aussi un réformateur actif. Mais la plupart des industriels se contentent d’administrer leur usine et la commune rurale où elle est située. Un Schneider, par exemple, disait à peu près : « Moi, je fais des factures et c’est tout ». Ce n’est pas le cas des Goüin.

Eugène Goüin (source : Wikipedia)
Eugène, par exemple, fait partie du groupe de la réforme pénitentiaire, qu’on peut considérer comme la matrice de la réforme sociale parisienne dans les années 1870 et 1880. A partir de l’Exposition universelle de 1889, il s’engage, comme ses pairs de ce groupe, dans la réforme de l’assistance, d’un côté, et dans la promotion des habitations à bon marché, de l’autre. Eugène est véritablement un archétype, mais c’est aussi le cas de Jules. Lui et sa femme sont engagés à la fois dans des œuvres catholiques, dans des œuvres patronales et dans la Société philanthropique. La Société philanthropique est une très vieille société qui, tout au long du XIXe siècle, a eu la particularité de regrouper des notables liés aux régimes successifs : légitimistes, orléanistes, bonapartistes, républicains. C’est un terrain neutre, un terrain de collaboration entre des gens qui, sur d’autres terrains – en particulier la politique – se disputent vigoureusement. A la Société Philanthropique, on fait la trêve pour conduire ensemble une œuvre généraliste de première importance. Nos analyses de réseaux montrent que Jules Goüin est particulièrement intéressant, car il constitue un pont entre le monde de la charité catholique, organisé autour de Monseigneur Richard, l’archevêque de Paris, et la philanthropie républicaine. C’est une famille absolument passionnante pour nous ! »
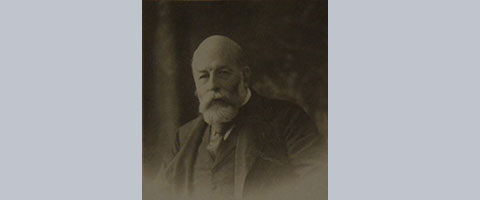
Jules Goüin (source : Wikipedia)
Finalement, pourquoi avoir choisi ce sujet d’étude ?
Christian Topalov : « Je travaille depuis longtemps sur ce que j’ai appelé dans un autre livre « les laboratoires du nouveau siècle », ces groupes de réformateurs sociaux qui ont conçu et contribué à faire naître – le sachant ou ne le sachant pas, le voulant ou ne le voulant pas – l’Etat social du XXe siècle. Pour eux, « réformer », c’était créer les conditions pour qu’advienne une nouvelle façon d’administrer le social, de protéger les travailleurs des aléas du marché du travail et des accidents de la vie, d’en faire des producteurs plus stables et plus efficaces. Aujourd’hui, c’est très paradoxal – et la conjoncture de ce mois de décembre 2019 nous le rappelle, s’il en était besoin – « réformer » veut dire exactement le contraire : déréguler, revenir à une concurrence libre et non faussée, rétablir, autant que possible, le règne sans partage du marché. C’est un paradoxe qui mérite réflexion. Si j’ai travaillé sur les philanthropes, c’est pour réfléchir sur ce que pouvait signifier, hier et aujourd’hui, la réforme. »
